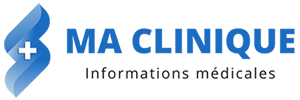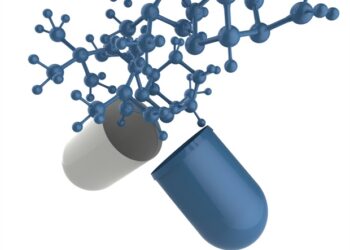Les crises convulsives sont les symptômes les plus fréquents en pratique neurologique pédiatrique. Ce terme a la même signification que « crise épileptique » chez l’adulte et n’implique pas toujours la notion d’épilepsie-maladie.
Les convulsions sont fréquentes (5 % de tous les enfants présenteront une ou plusieurs crises convulsives), de gravité variable ; posant toujours en priorité le problème de leur cause, du risque de récidive, et de l’urgence thérapeutique.
Sommaire
Définition des convulsions
Les convulsions sont des crises de contracture musculaire, d’origine cérébrale. Elles sont liées à « l’excitation d’un groupement neuronal plus ou moins important, avec tendance à la diffusion à l’ensemble de l’encéphale ».
- les contractures sont soit toniques (contractures soutenues), soit cloniques (secousses régulières intermittentes), soit tonico-cloniques lorsque les deux séquences se succèdent.
- l’origine cérébrale : les manifestations musculaires s’accompagnent presque toujours d’une perte de conscience et quelquefois de troubles neurovégétatifs ; la reprise de conscience sera lente après la fin de la crise (syndrome post-critique). Des séquelles neurologiques peuvent suivre définitivement une crise très prolongée.
- « l’excitation d’un groupement neuronal » : ce n’est que le mécanisme de production et non le symptôme lui-même ; il implique la notion d’un fonctionnement anarchique et paroxystique tendant à l’épuisement des réserves énergétiques de ce groupement. Un de ces aspects en est électrique (électroencéphalogramme) par production d’une « décharge » E.E.G. percritique qui n’est que l’expression de l’hyperfonctionnement biologique ; une convulsion n’est pas une décharge électrique mais un symptôme clinique.
- la tendance à la diffusion est variable selon l’âge : elle est d’autant plus limitée que l’enfant est plus jeune et la signification de crises partielles n’est pas la même chez le grand enfant, l’adolescent ou l’adulte, que chez le nourrisson ou le nouveau-né.
Différents type de crises de convultions
Crises généralisées
L’ensemble de la musculature est simultanément intéressé par les contractures. Les crises peuvent être tonicocloniques, toniques pures, cloniques pures. Le syndrome post-critique est une obnubilation avec hypotonie transitoire.
Hémicrises
Les mêmes aspects sémiologiques sont possibles mais sur une moitié du corps seulement (crises hémi tonico-cloniques ; hémitoniques ou hémicloniques). Si ces crises peuvent être la conséquence d’une lésion unilatérale de l’encéphale, elles peuvent aussi se produire chez le nourrisson comme équivalent de crises généralisées, « sans valeur localisatrice ». Le syndrome post-critique est une hémiplégie transitoire.
Crises partielles
Leur topographie est encore plus limitée (un pied, une main, une hémiface, de simples clonies palpébrales …) quelquefois fixe, ailleurs changeant de topographie au long de la crise (crises erratiques). Comme les précédentes, elles peuvent n’avoir aucune valeur localisatrice, notamment chez le nouveau-né et le très petit nourrisson. Leur reproduction répétitive au même endroit du corps doit faire rechercher cependant la lésion causale localisée.
Crises hypotoniques
Résolution musculaire complète accompagnée quelquefois d’un plafonnement des yeux et dequelques secousses des paupières avec inconscience. Propres à l’enfant jeune (1 à 2 ans), elles n’ont pas de significations étiologiques ou pronostiques particulières.
Etat de mal convulsif
Tous les types de crises déjà envisagés, en se prolongeant au-delà d’une ½ heure, peuvent réaliser un état de mal. Cette situation est d’autant plus fréquente chez l’enfant qu’il est plus jeune, même pour des causes très bénignes. Elle implique une gravité supplémentaire par épuisement neuronal productif de séquelles et une plus grande résistance au traitement.
Spasmes axiaux
Ce sont des crises très spécifiques aux nourrissons. Elles surviennent toujours dans des situations étiologiques graves (encéphalopathie convulsivante – maladie dégénérative) . Ce sont des crises complexes portant le corps en flexion antérieure (spasmes en flexion) ou en hyperextension (spasmes en extension), survenant par courtes salves répétitives ; leur aspect E.E.G. est particulier (hypsarythmie) ; leur retentissement psycho-moteur est majeur.
Ainsi, l’aspect sémiologique des crises est-il très varié. Cette variété est fonction de l’âge (topographie-durée), mais aussi de l’étiologie (seuls les spasmes axiaux ont des étiologies particulières, les autres types de crise n’ont aucune spécificité).
Diagnostics
Diagnostic positif
Il est uniquement clinique : il repose sur l’association contracture musculaire + troubles de la conscience, que l’on assiste à la crise, ou que l’on obtienne par l’interrogatoire le plus de détails possible sur son déroulement et ses manifestations. L’électroencéphalogramme n’a aucune valeur pour le diagnostic positif car il est toujours fait après la crise et ne peut à la rigueur qu’objectiver des signes post-critiques d’interprétation très délicate.
Diagnostic préférentiel
- nouveau-né : trémulations de l’endormissement, frissons, myoclonies néonatales bénignes
- nourrisson : tous les malaises graves induits par reflux gastro-oesophagien, hypoglycémie, mort subite manquée. Les spasmes du sanglot sont des syncopes bénignes avec quelquefois hypertonie, provoquées par l’anoxie consécutive au blocage respiratoire concluant une crise de sanglot particulièrement intense. La tétanie hypocalcémique du nourrisson ne comporte en règle pas de troubles de la conscience et représente une crise hypertonique de sémiologie très particulière. Les syndromes dystoniques, notamment médicamenteux (Primpéran), peuvent être confondus avec des crises convulsives. Les rythmies de l’endormissement sont faciles à différencier par leur déroulement lent et sans vraie contracture musculaire
- chez le grand enfant, les malaises vagaux, en règle provoqués par un stimulus, et les crises névropathiques, possibles à tout âge, ne résistent pas à un interrogatoire minutieux.
Ainsi le diagnostic d’une crise convulsive est-il essentiellement clinique et en règle générale facile quand on y assiste. Il peut être difficile dans le cas contraire lorsque l’interrogatoire de l’entourage est imprécis ou lorsque la crise n’a pas eu de spectateur, l’enfant étant découvert en coma postcritique.
Diagnostic étiologique
Des crises convulsives peuvent survenir dans trois cadres étiologiques distincts :
Pathologie cérébrale lésionnelle
Toute les classes de lésions cérébrales peuvent provoquer des crises convulsives, généralisées ou partielles :
- les traumatismes crâniens : les crises convulsives immédiates sont liées à la commotion seule. Les convulsions secondaires peuvent avoir valeur de complications (hématomes-oedème) et justifient une exploration.
- les situations d’anoxie cérébrale (asphyxie, corps respiratoire, noyade …) peuvent comporter des crises accompagnant les troubles de la conscience et aggravant la souffrance cérébrale.
- les hémorragies intra-crâniennes (diffuses ou hématomes) sont convulsivantes.
- les phénomènes ischémiques artériels (thrombose) ou veineux (thrombophlébite) provoquent des crises, en règle partielles.
- les compressions cérébrales (tumeurs hémisphériques, hématomes, kystes arachnoïdiens, hydrocéphalie), font convulser dans un tableau d’HTC.
- les causes infectieuses sont les plus fréquentes, accompagnées de fièvre. On les trouve dans les encéphalites ou les méningo-encéphalites.
- les maladies métaboliques héréditaires, les maladies dégénératives, doivent être évoquées dans des situations de dégradation neurologique progressive avec convulsions.
- les encéphalopathies chroniques « fixées », séquelles de pathologies antérieures, s’accompagnent de crises souvent rebelles, élément supplémentaire de leur gravité.
- les malformations cérébrales (dysplasies, cavernomes, hémimégalencéphalie…), sont seulement reconnues à l’IRM.
En règle, toutes ces situations lésionnelles, sont immédiatement évoquées lorsque le tableau clinique, est enrichi de manifestations neurologiques déficitaires intercritiques, d’un syndrome méningé, d’une HTC, ou de tout autre élément d’accompagnement à l’examen. Elles requièrent outre une enquête anamnestique précise, des explorations adaptées à chaque cas : neuroradiologie, analyse du liquide céphalo-rachidien.
La survenue de convulsions signe la gravité des lésions en cause et implique la notion d’urgence de la prise en charge.
Pathologie « fonctionnelle » cérébrale
Les crises surviennent ici en dehors de toute lésion cérébrale initiale. Leur prolongation cependant peut en provoquer. Une hémicrise prolongée, par exemple hyperthermique, peut être à l’origine du classique syndrome hémiconvulsion-hémiplégie (définitive) (syndrome H.H).
Pathologie métabolique aiguë
Les situations d’hypocalcémie (inférieure à 2 mmol/l), d’hypoglycémie (inférieure à 2,5mmol/l), de perturbations hydroélectrolytiques (notamment hyponatrémie profonde ou à l’inverse hypernatrémie lors de déshydratation), peuvent provoquer des états de mal convulsif prolongés qui ne céderont qu’avec le rétablissement de la normalité métabolique.
Des substances toxiques, et notamment médicamenteuses, peuvent être convulsivantes chez le nourrisson. Les pénicillines à fortes doses, la théophylline, les analeptiques respiratoires, en sont des exemples, comme les vasoconstricteurs nasaux contenant de l’éphédrine.
Convulsions fébriles
Il s’agit là de la cause la plus commune de convulsions de l’enfant entre 1 et 3 ans. La fièvre seule est en cause, à l’exclusion de toute pathologie infectieuse encéphalique, avec une sensibilité personnelle souvent rendue par l’existence d’antécédents familiaux. Les crises peuvent être de tout type (mis à part les spasmes axiaux), et peuvent être prolongées. La fièvre peut n’apparaître qu’en fin de crise ; le degré thermique atteint est très variable. Toute variation thermique brutale, peut, chez les sujets prédisposés, être l’élément déclenchant. Le diagnostic de convulsion fébrile ne peut être affirmé qu’après exclusion d’une infection cérébro-méningée. La P.L est un geste fondamental pour le diagnostic différentiel. Si toutes les causes de fièvre peuvent être déclenchantes, ce sont surtout les infections rhinopharyngées et certaines maladies éruptives (rougeole, exanthème subit), qui sont le plus souvent en cause.
Le type de crise réalisé permet la distinction en :
- « crise fébrile » simple : crise brève de type généralisé, de durée inférieure à 2 minutes, chez un enfant de plus de 15 mois, sans antécédents pathologiques, sans syndrome post-critique prolongé. Ce sont les plus fréquentes (80 %), d’évolution simple. L’incidence de l’épilepsie ultérieure n’y est pas supérieure à celle généralement observée (5 %).
- crise convulsive « complexe » : crise longue, souvent asymétrique, chez un enfant aux antécédents troublés, suivie souvent d’un syndrome post-critique prolongé, d’autant qu’il s’agit plus facilement de crise partielle. Ce sont les plus rares (20 %) mais leur pronostic et l’incidence de leur récidive (30 % des cas) est plus préoccupant, et une évolution épileptogène ultérieure beaucoup plus fréquente (15 %) que dans la population générale (5 %). Leur répétition presque systématique pour des fièvres de moins en moins élevées fait redouter « l’épilepsie myoclonique sévère du nourrisson ».
Ces caractères sémiologiques sont fondamentaux à préciser. Ils restent du domaine de la clinique, et conditionnent le traitement (voir plus loin).
Epilepsie
Une ou plusieurs crises convulsives, sans cause évidente retrouvée, peuvent s’inscrire dans le domaine d’une épilepsie chronique au début. C’est la tendance récidivante qui définit ce cadre ; l’analyse électroencéphalographique est ici d’un intérêt majeur puisque c’est dans ce seul cas que des anomalies paroxystiques persistent sur le tracé en dehors des crises (tracé intercritique), de façon diffuse ou focale. L’E.E.G., pour être interprétable, doit être réalisé loin de la crise initiale (15 jours à 3 semaines), au risque de n’enregistrer que des éléments post-critiques sans valeur étiologique. Des techniques de sensibilisation de l’EEG (hyperpnée-sommeil) peuvent être nécessaires pour identifier ces anomalies intercritiques.
Causes selon l’âge
Chez le nouveau-né
Les causes lésionnelles priment (anoxo-ischémie, infections, hémorragies intra-crâniennes, malformations, embryofoetopathies …). Une mention particulière doit être faite des convulsions idiopathiques dites « convulsions du 5ème jour », apparemment non lésionnelles, d’évolution brève dans le temps. Elles sont considérées actuellement, sous le terme de « convulsions néonatales bénignes » comme une forme particulière d’épilepsie, à l’avenir le plus souvent transitoire (quelques semaines ou mois), quelquefois plus prolongé (quelques années).
De même, parmi les causes métaboliques, il faut mentionner les convulsions « pyridoxinosensibles », dont le seul diagnostic repose sur l’effet thérapeutique de l’injection intra-veineuse ou intra-musculaire de vitamine B6.
Chez le nourrisson et le petit enfant
La primauté étiologique revient aux causes fonctionnelles, avec en premier lieu la prévalence majeure des convulsions fébriles, surtout entre l’âge de 15 mois et de 3 ans. Plus rarement la survenue de convulsions est due à des maladies métaboliques héréditaires, ou à l’épilepsie primaire précoce. Des « encéphalopathies épileptogènes » , cadre de l’épilepsie « secondaire » et « cryptogénique » dont le modèle est le syndrome de West du nourrisson, du syndrome de Lennox-Gastaut plus tard sont cependant possibles, d’expressivité EEG très riche et de pronostic toujours réservé.
Chez le grand enfant au-delà de 3 ans
La prévalence des crises fonctionnelles s’amenuise largement, au profit des crises « symptomatiques » (de pathologie organique), et surtout des diverses formes d’épilepsie, dont la fréquence ira en croissant avec l’âge.
Orientation du diagnostic devant une première crise convulsive
Elle suit immédiatement le geste thérapeutique d’urgence (voir plus loin) nécessaire à l’arrêt de la crise.
C’est évident :
Antécédents convulsifs connus ; pathologie neurologique déjà précédemment expressive.
Contexte de survenue : traumatisme crânien, intoxication, anoxie ; oubli du traitement chez un enfant épileptique traité.
Ce n’est pas évident (notamment en cas de premier épisode) :
Dans tous les cas
- examen clinique (symptômes déficitaires résiduels – fièvre – maladie en cours …)
- recherche anamnestique récente ou éloignée ..
L’enfant est fébrile : convulsion fébrile ? infection du système nerveux (méningite ou méningo-encéphalite) ?
C’est avant tout la ponction lombaire qui doit être discutée. Systématique avant 18 mois, elle est réservée, au-delà, aux cas où est constaté un syndrome méningé clinique ou lorsqu’on ne retrouve pas de cause à la fièvre à l’examen. L’EEG n’est d’aucun intérêt dans les convulsions fébriles.
L’enfant est apyrétique. Des examens sont à réaliser.
Certains en urgence car à incidence thérapeutique immédiate : dosages de la glycémie, de la calcémie, des électrolytes sanguins.
D’autres, ensuite si les premiers sont normaux : fond d’oeil, ponction lombaire (si raideur) mais surtout tomodensitométrie cérébrale.
L’EEG n’est urgent qu’en cas de suspicion d’encéphalite de l’herpès ou de syndrome de West car la décision thérapeutique immédiate en dépend. Il sera, ailleurs, à réaliser avec le délai utile à la disparition des éléments post critiques car son seul intérêt réside dans l’identification d’un syndrome épileptique.
Ces examens paracliniques peuvent identifier une cause lésionnelle ou une épilepsie. Ils peuvent à l’inverse être négatifs, avec par ailleurs récupération clinique normale. Ces crises apyrétiques « primitives » requièrent une surveillance ultérieure : début d’une maladie neurologique ? entrée dans une forme d’épilepsie ? Certaines crises apyrétiques ne se reproduiront jamais : crises idiopathiques. La mise de ces enfants sous traitement antiépileptique est dans ce cas toujours contrebattue. La surveillance devra se faire cliniquement (développement psychomoteur, dépistage d’un déficit neurologique) et par E.E.G (apparition d’éléments paroxystiques signant l’épilepsie et imposant son traitement). Le recours à un complément d’investigations (biochimiques, électrophysiologiques, ou par imagerie) dépendra aussi de cette évolution et ne devra pas être envisagé d’emblée.
Traitement des convulsions chez l’enfant
Traitement curatif (immédiat)
Chez l’enfant, toute crise convulsive doit être traitée, sans attendre son interruption spontanée.
Le Diazepam (Valium®) est l’anticonvulsivant de choix. Disponible en ampoules de 2 ml (10 mg) il est administré à la dose de 0,5 mg/kg. La voie intrarectale est la plus pratique, alliant sécurité (à l’inverse de la voie I.V) et efficacité (action en 2 minutes environ à l’inverse de la voie I.M active en 15 minutes). Elle nécessite une seringue, une canule d’injection et la dilution du Valium dans un volume équivalent de sérum physiologique.
L’enfant est mis en position latérale de sécurité, protégé des traumatismes, en s’assurant de la liberté de ses voies respiratoires en protégeant langue et dents chez le grand. Le traitement de la fièvre devra suivre si l’enfant est fébrile, par une dose de 10 mg/kg d’aspirine, de paracétamol ou d’ibuprofène.
On peut renouveler l’administration de Valium, si la crise dure, ¼ d’heure après la première injection, pour la durée du transport en établissement d’hospitalisation d’urgence. Le recours aux barbituriques (Gardenal®) ou aux hydantoïnes (Dilantin®) par voie I.V (10 mg/kg en ¼ d’heure) ne peut être réalisé, si la crise est devenue un état de mal, qu’en hospitalisation ou en véhicule médicalisé en étant prêt à contrôler la respiration.
Traitement préventif (au long cours)
Chaque fois que se pose le problème de la prévention des récidives de crise, le traitement instantané devra être rapidement secondé par un traitement de fond, qui fait appel :
- soit au Valproate de sodium (Dépakine) à la dose de 25 à 40 mg.kg/jour en deux prises
- soit au Phénobarbital (Gardenal) à la dose de 3 à 5 mg/kg/jour en deux prises.
D’autres anticonvulsivants sont disponibles ; ils font partie du traitement de l’épilepsie chronique.
En ce qui concerne les crises fébriles, la décision d’un traitement préventif (traitement quotidien pendant 2 ans), dépend grandement du type de crise réalisé.
Les crises « simples » ne justifient pas en règle de traitement préventif des récidives, mais seulement l’administration d’antipyrétiques et éventuellement de Diazepam en cas d’hyperthermie.
Les crises « complexes » doivent à l’inverse faire l’objet d’un traitement préventif, car la probabilité de leur récidive est plus importante et celle-ci peut revêtir une gravité qui engage le pronostic neurologique ultérieur. Il en est de même lorsque la première crise fébrile survient avant l’âge de un an, facteur de gravité pour l’avenir. Enfin, lorsqu’un contrôle électroencéphalographique, réalisé 15 jours après la crise fébrile montre la persistance d’anomalies importantes, cet élément peut rentrer en compte dans la décision d’un traitement préventif ultérieur.
Objectifs (urgence pédiatrique)
Diagnostiquer une convulsion chez le nourrisson et chez l’enfant
Décrire les différents types de crises. Discuter le diagnostic différentiel. Bien se rappeler que tout ce diagnostic est clinique et que les examens complémentaires sont à visée étiologique.
Donner ensuite l’orientation étiologique (page 5) en donnant quelques détails sur « convulsions fébriles ».
Identifier les situations d’urgence
Toute crise convulsive est potentiellement une situation d’urgence.
- sémeiologiquement à cause de sa durée et du risque d’état de mal, producteur de séquelles ou de risque vital
- étiologiquement à cause des situations lésionnelles (à développer rapidement).
Bien insister sur la notion de durée de la crise quand on prend l’enfant en charge, sur le retentissement respiratoire et neurovégétatif constaté ; développer la notion d’état de mal et de syndrome post-critique. Ceci justifie le traitement curatif immédiat comme premier réflexe dès qu’une crise est constatée.
Etiologiquement, les situations d’urgence sont identifiées par les symptômes associés aux crises :
- enfant fébrile et recherche de méningite ou de méningo-encéphalite (PL – EEG). Discussion du traitement antibiotique ou antiviral (acyclovir) en fonction du résultat de ces examens et de l’état post-critique
- enfant apyrétique : l’urgence est identifiée par l’état neurologique une fois la crise (et le syndrome post-critique) dissipée. La persistance de signes déficitaires justifie neuroradiologie et PL, plus qu’EEG, à la recherche des étiologies lésionnelles, surtout dans les situations traumatiques, de suspicion d’HTIC ou de syndrome méningé apyrétique.
Ici encore la notion d’urgence est d’appréciation clinique (interrogatoire de l’entourage –examens cliniques répétés…)
Planifier leur prise en charge
Envisager successivement :
- le traitement d’urgence, premier réflexe du médecin
- l’orientation étiologique une fois la crise terminée
- la décision d’un traitement symptomatique au long cours, qui est fonction de l’étiologie retenue
- bien connaître les arguments du traitement au long cours des convulsions fébriles