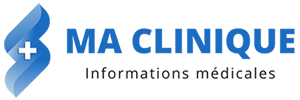Le COVID-19 a été la première pandémie qui s’est produite parallèlement à l’interconnectivité d’Internet. Par conséquent, la diffusion d’idées et d’informations sur la maladie a été sans précédent ; mais pas toujours précis. L’un des titres les plus largement diffusés était celui de la relation entre le changement des terres et la propagation des maladies de la faune aux humains. Écrire dans Bioscience, Andre D. Mader de l’Institute for Global Environmental Strategies et ses collègues étudient la littérature primaire et secondaire, ainsi que le contenu des pages Web sur le sujet du changement des terres et du risque de maladie zoonotique. Sur la base des modèles tirés de cette littérature et de la couverture médiatique, Mader et ses collègues décrivent ce qui équivaut à une étude de cas sur la communication scientifique inappropriée et ses conséquences possibles.
Selon les auteurs, les messages médiatiques ont systématiquement décrit une causalité directe entre la propagation des maladies zoonotiques et le changement d’utilisation des terres, malgré le fait que seulement 53 % de la littérature examinée par les pairs interrogée ait fait cette association. Les auteurs se penchent sur des scénarios théoriques qui démontreraient la difficulté de retracer le risque réel de propagation zoonotique, soulignant que « la complexité des réponses des agents pathogènes au changement des terres ne peut être réduite à des proclamations uniformes ».
Les auteurs ont constaté qu’à mesure que la littérature passe de la recherche primaire aux articles de synthèse et aux commentaires, et enfin aux pages Web, la « surestimation des preuves » augmente, avec 78 % des articles secondaires impliquant l’association entre l’utilisation des terres et les retombées zoonotiques et tous sauf un. les pages Web échantillonnées faisant cette association. Les auteurs ont également noté que les sources secondaires et les pages Web omettaient souvent de mentionner l’incertitude associée à leurs conclusions.
Les conséquences potentielles d’un message simpliste et d’un manque de communication appropriée concernant les retombées zoonotiques peuvent éroder la crédibilité, négliger les besoins spécifiques de la communauté locale en matière d’élaboration de politiques et détourner l’attention d’autres facteurs qui peuvent conduire à des retombées zoonotiques, disent Mader et ses collègues. Les auteurs recommandent une diffusion plus précise, nuancée et explicative des études sur le risque de propagation zoonotique, arguant qu’une telle approche profiterait également à la science plus largement. Comme le concluent les auteurs, « si l’objectif de la communication scientifique est d’améliorer la compréhension, elle doit trouver un équilibre : une simplicité suffisante pour être comprise par un public aussi large que possible, mais suffisamment de nuances pour saisir la complexité d’un problème et contribuer de manière significative à la discussion autour de ça, surtout quand ça devient viral. »